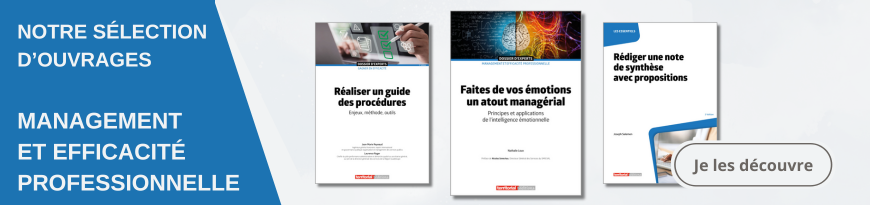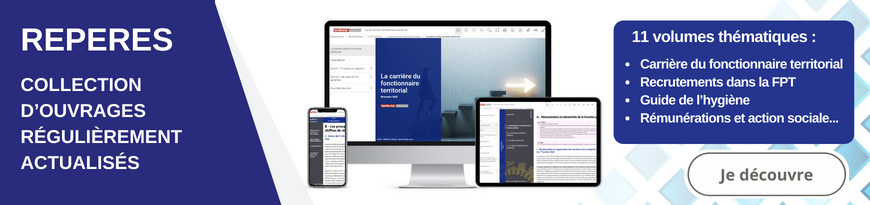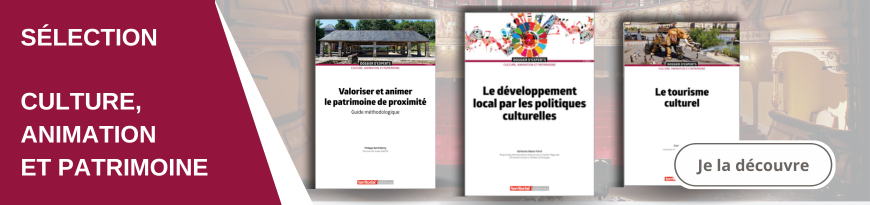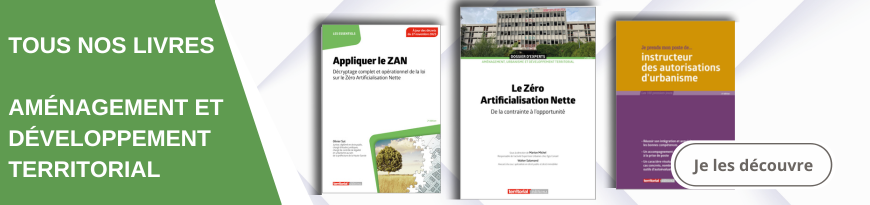-
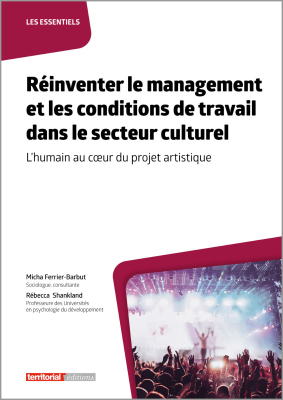 Réinventer le management et les conditions de travail dans le secteur culturelÀ partir deÀ partir de 39,00 € TTC
Réinventer le management et les conditions de travail dans le secteur culturelÀ partir deÀ partir de 39,00 € TTCAllier excellence artistique et performance sociale
-
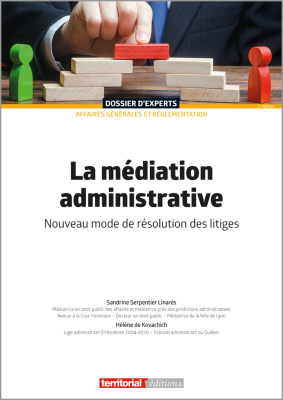 La médiation administrativeÀ partir deÀ partir de 55,00 € TTC
La médiation administrativeÀ partir deÀ partir de 55,00 € TTCConduire un processus de médiation administrative
-
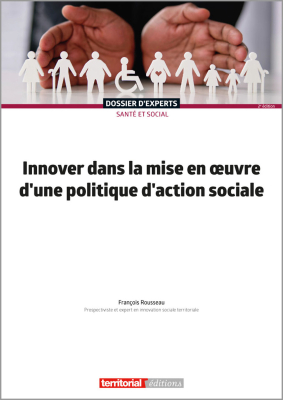 Innover dans la mise en oeuvre d'une politique d'action socialeÀ partir deÀ partir de 55,00 € TTC
Innover dans la mise en oeuvre d'une politique d'action socialeÀ partir deÀ partir de 55,00 € TTCÉlaborer une politique territoriale d'action sociale durable et innovante
-
 Je prends mon poste de responsable des équipements sportifs ou culturelsÀ partir deÀ partir de 29,00 € TTC
Je prends mon poste de responsable des équipements sportifs ou culturelsÀ partir deÀ partir de 29,00 € TTCUn accompagnement indispensable dans votre prise de poste de responsable des équipements sportifs ou culturels !
-
 Comprendre les finances localesÀ partir deÀ partir de 55,00 € TTC
Comprendre les finances localesÀ partir deÀ partir de 55,00 € TTCL'outil indispensable pour comprendre les mécanismes et enjeux de l'exécution d'un budget
-
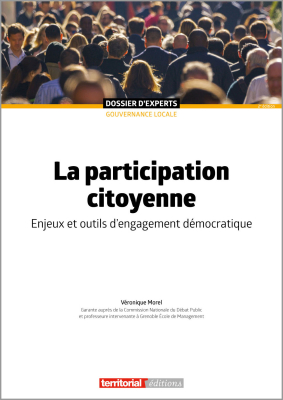 La participation citoyenneÀ partir deÀ partir de 55,00 € TTC
La participation citoyenneÀ partir deÀ partir de 55,00 € TTCDes solutions concrètes pour réussir un projet de participation citoyenne et revitaliser la démocratie
-
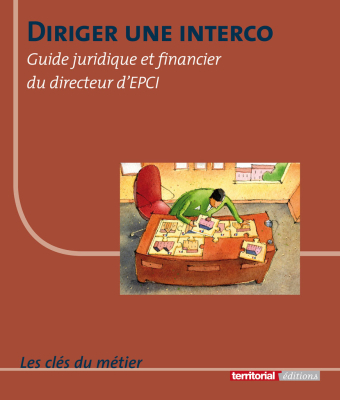 Diriger une interco - Guide juridique et financier du directeur d'EPCIÀ partir deÀ partir de 205,00 € TTC
Diriger une interco - Guide juridique et financier du directeur d'EPCIÀ partir deÀ partir de 205,00 € TTCPour sécuriser juridiquement la gestion de votre EPCI
-
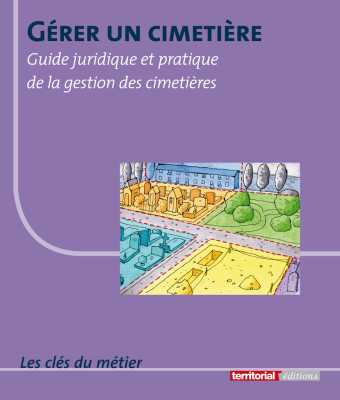 Gérer un cimetièreÀ partir deÀ partir de 179,00 € TTC
Gérer un cimetièreÀ partir deÀ partir de 179,00 € TTCUn outil pour une gestion rigoureuse des cimetières
-
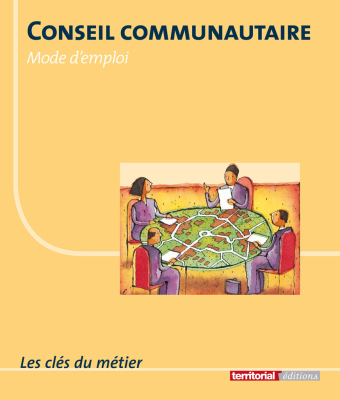 Conseil communautaire, mode d'emploiÀ partir deÀ partir de 189,00 € TTC
Conseil communautaire, mode d'emploiÀ partir deÀ partir de 189,00 € TTCUn ouvrage de référence pour les dirigeants des EPCI
-
 Modèles de délibérations : Aménagement - Environnement - UrbanismeÀ partir deÀ partir de 99,00 € TTC
Modèles de délibérations : Aménagement - Environnement - UrbanismeÀ partir deÀ partir de 99,00 € TTCGagner du temps et faciliter la rédaction des actes administratifs
-

-
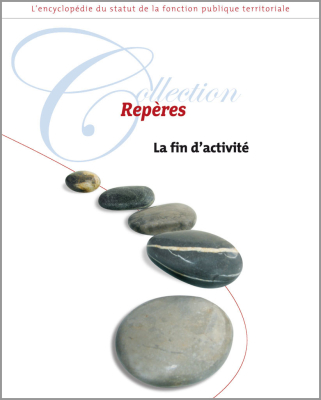
-
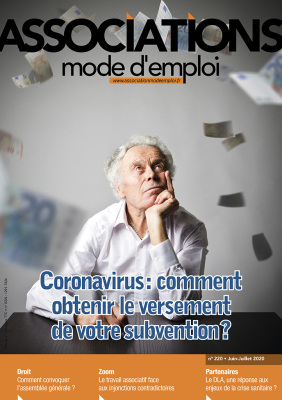 Associations mode d'emploiÀ partir deÀ partir de 119,00 € TTC
Associations mode d'emploiÀ partir deÀ partir de 119,00 € TTCLe mensuel de référence des professionnels et bénévoles associatifs
Évaluation moyenne des clients :5 of 5 -
 Club Acteurs du sportÀ partir deÀ partir de 199,00 € TTC
Club Acteurs du sportÀ partir deÀ partir de 199,00 € TTCLe Club 100% numérique et tous les contenus et services du site
-
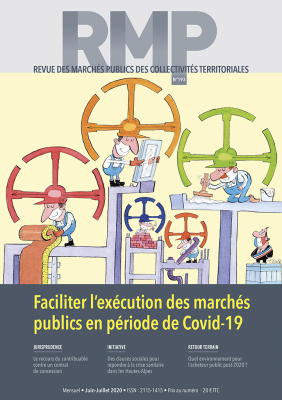 La revue des marchés publicsÀ partir deÀ partir de 84,00 € TTC
La revue des marchés publicsÀ partir deÀ partir de 84,00 € TTCLe mensuel des marchés publics qui vous informe en continu sur les perpétuelles évolutions du secteur.
-
 MONITEUR JURIS Contrats Publics1 125,00 € TTC
MONITEUR JURIS Contrats Publics1 125,00 € TTC12 livres + 4 ouvrages à mises à jour + 2 revues + tous les textes officiels + toute la jurisprudence
-
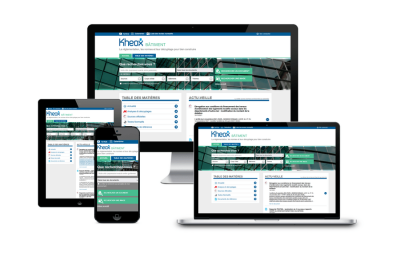
-
 BATIPRIX WEBÀ partir deÀ partir de 238,80 € TTC
BATIPRIX WEBÀ partir deÀ partir de 238,80 € TTCGagnez du temps dans le chiffrage de travaux avec la solution Batiprix Web !